 Né le 21 décembre 1639 à la Ferté-Milon (Aisne), élevé en partie à Port-Royal, et destiné d’abord à la théologie, Jean Racine est le troisième monstre sacré du théâtre au dix-septième siècle, avec Molière et Corneille. Pourtant sa carrière commença bien mal puisqu’il fit représenter, en 1664, une première et médiocre tragédie, la Thébaïde, ou les Frères ennemis. La seconde, Alexandre (1665), fut déjà nettement meilleure. Puis Il faudra attendre Andromaque (1667) pour qu’enfin son génie se révèle dans toute sa splendeur. Ensuite viendront l’amusante comédie des Plaideurs (1668) ce qui témoigne de son éclectisme, et six tragédies qui sont autant de chefs d’œuvre : Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie en Aulide (1674), Phèdre (1677).
Né le 21 décembre 1639 à la Ferté-Milon (Aisne), élevé en partie à Port-Royal, et destiné d’abord à la théologie, Jean Racine est le troisième monstre sacré du théâtre au dix-septième siècle, avec Molière et Corneille. Pourtant sa carrière commença bien mal puisqu’il fit représenter, en 1664, une première et médiocre tragédie, la Thébaïde, ou les Frères ennemis. La seconde, Alexandre (1665), fut déjà nettement meilleure. Puis Il faudra attendre Andromaque (1667) pour qu’enfin son génie se révèle dans toute sa splendeur. Ensuite viendront l’amusante comédie des Plaideurs (1668) ce qui témoigne de son éclectisme, et six tragédies qui sont autant de chefs d’œuvre : Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie en Aulide (1674), Phèdre (1677).
A cette époque, lassé des attaques de ses adversaires, de plus en plus préoccupé de son salut et de ce qu’il doit à Dieu, se consacrant aussi aux devoirs nouveaux que lui crée son mariage (1677) après une vie dissolue jusque-là, plus le cœur qu’il met dans sa charge d’historiographe du roi, l’accompagnant dans toutes ses campagnes, il renonce au théâtre. Toutefois, cédant aux supplications de Madame de Maintenon, il fait représenter à Saint-Cyr, Esther (1689), et dans les appartements du roi, Athalie (1691), la plus originale de ses productions. A ce propos, plus généralement, le théâtre de Racine nous offre le modèle le plus accompli de la tragédie française classique, et l’on chercherait vainement quelle sorte de mérite a manqué à ce grand homme. Tout y était : propriété du style, souplesse de la versification, juste ordonnance d’une intrigue naissant du choc même des passions, mais aussi naturel et profondeur dans la peinture des caractères les plus complexes.
Les chœurs d’Esther et d’Athalie, ainsi que les quatre Cantiques spirituels qu’il publia en 1694, assurent encore à Racine un rang élevé parmi les poètes lyriques de la France. Ses épigrammes, ainsi que quelques uns de ses écrits en prose, décèlent l’esprit le plus fin, le plus aiguisé, parfois aussi le plus mordant, notamment vis-à-vis des Messieurs de Port-Royal, ces derniers ne louant que leurs amis et n’ayant de cesse de critiquer leurs ennemis au mépris de la vérité, sans oublier ses railleries cruelles à l’égard des magistrats dans les Plaideurs. Bref, Racine était un génie de la littérature et du théâtre, ce qui lui permit, avec Boileau, d’être nommé historiographe du roi (1677) sur proposition de la marquise de Montespan (maîtresse du roi) et sa sœur, Madame de Thianges. Cette nomination lui valut de nombreuses inimitiés, dont celle de Madame de Sévigné qui soutenait plutôt son cousin pour accomplir cette mission.
Dans ce cadre il s’était occupé d’amasser pendant des années des matériaux pour écrire l’histoire du règne de Louis XIV. Hélas, à l’exception de quelques fragments, tout périt dans l’incendie de la maison que Valincour, son successeur comme historiographe, possédait à Saint-Cloud (1726). Cet accident était d’autant plus fâcheux que les travaux de Racine avaient une haute valeur historique, même si certains lui avaient reproché de faire la part trop belle à son grand roi, ce en quoi ils avaient tort, car Racine s’était aussi plu à faire ressortir les belles actions des simples soldats, éternels oubliés après les combats. Racine mourut le 22 avril 1699 et fut enterré à Port-Royal.
Parmi les écrits en prose de Racine, il y en a un qui retient particulièrement l’attention, le Discours prononcé dans l’Académie française le 2 janvier 1685, dans lequel Racine répond en qualité de directeur de l’Académie française au discours de réception de Thomas Corneille, élu en remplacement de son frère, et lui-même auteur d’un grand nombre de tragédies, dont les plus connues sont Ariane et le Comte d’Essex. Dans ce discours, Racine fait ressortir les grandes qualités de Corneille, notamment celle consistant pour les auteurs s’inspirant de l’espagnol, d’avoir su prêter à des personnages héroïques un langage et des sentiments naturels. Il en profitera aussi, à travers son compliment à l’auteur du Cid, pour flatter une nouvelle fois Louis XIV qu’il appelle Louis le Grand, par une phrase admirable dont il avait le secret : « La France se souviendra avec plaisir que, sous le règne du plus grand de ses rois, a fleuri le plus grand de ses poètes ».
Un dernier mot enfin pour souligner la chance que j’ai eue d’avoir des professeurs de français qui aimaient Racine, et qui m’ont fait découvrir à travers les pièces que nous étudions la diversité de son théâtre. Dans Bérénice, nous sommes en présence d’une pièce qui est d’abord une élégie sentimentale et romanesque. La séparation forcée de deux amoureux est toujours triste, comme en témoignent les larmes des deux héros, mais ce n’est pas pour autant un spectacle tragique. Dans Andromaque et Iphigénie Racine apparaît comme le poète de la passion et de ses désordres, ce qui n’empêche pas ses héros d’exprimer avec une touchante délicatesse les plus nobles sentiments du cœur. Dans Phèdre, la passion va au-delà de l’entendement et devient une folie qui provoque les pires catastrophes. En fait le poète est remarquable parce qu’il est capable de pénétrer jusqu’aux dernières divisions de la conscience.
Michel Escatafal
 Né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, mort à Paris le 13 avril 1695, Jean de la Fontaine qui hérita d’une charge de maître des eaux et forêts que son père avait exercée, et qui fut marié à vingt-six ans, dut renoncer bientôt à son emploi tout en se montrant époux aussi peu recommandable qu’incapable magistrat. Les anecdotes si abondantes que la tradition nous a conservées sur ses habitudes et ses distractions ne sont sans doute pas toutes vraies, mais l’impression que sa conduite avait laissée dans les esprits doit s’y refléter. Jusque dans sa vieillesse, sa vie manqua toujours de gravité, même s’il sut faire preuve de fidélité vis-à-vis de ses bienfaiteurs. Parmi ceux-ci le surintendant Fouquet qui en fit son protégé, au point de le faire vivre chez lui pendant sept ans. La Fontaine lui resta fidèle dans la disgrâce et écrivit en sa faveur l’Elégie aux nymphes de Vaux (1661) et une Ode au roi (1663).
Né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry, mort à Paris le 13 avril 1695, Jean de la Fontaine qui hérita d’une charge de maître des eaux et forêts que son père avait exercée, et qui fut marié à vingt-six ans, dut renoncer bientôt à son emploi tout en se montrant époux aussi peu recommandable qu’incapable magistrat. Les anecdotes si abondantes que la tradition nous a conservées sur ses habitudes et ses distractions ne sont sans doute pas toutes vraies, mais l’impression que sa conduite avait laissée dans les esprits doit s’y refléter. Jusque dans sa vieillesse, sa vie manqua toujours de gravité, même s’il sut faire preuve de fidélité vis-à-vis de ses bienfaiteurs. Parmi ceux-ci le surintendant Fouquet qui en fit son protégé, au point de le faire vivre chez lui pendant sept ans. La Fontaine lui resta fidèle dans la disgrâce et écrivit en sa faveur l’Elégie aux nymphes de Vaux (1661) et une Ode au roi (1663). Né à Dreux (en 1609) d’une famille de magistrats, Jean Rotrou eut une vie assez échevelée. Avocat sans pratique, il fut en fait un professionnel de l’écriture, vivant du produit de ses pièces. Il n’avait pas 20 ans quand il fit représenter sa première comédie, l’Hypocondriaque, tragi-comédie dont s’inspirera Goethe pour son opérette Lila. Il fit partie de la Compagnie des cinq auteurs chargés de développer les canevas dramatiques inventés par le cardinal de Richelieu : les quatre autres étaient Corneille, Boisrobert (1592-1662), Claude de l’Estoile (1597-1652) et Guillaume Collet (1598-1659). Rotrou a écrit des comédies, des tragi-comédies, et des tragédies.
Né à Dreux (en 1609) d’une famille de magistrats, Jean Rotrou eut une vie assez échevelée. Avocat sans pratique, il fut en fait un professionnel de l’écriture, vivant du produit de ses pièces. Il n’avait pas 20 ans quand il fit représenter sa première comédie, l’Hypocondriaque, tragi-comédie dont s’inspirera Goethe pour son opérette Lila. Il fit partie de la Compagnie des cinq auteurs chargés de développer les canevas dramatiques inventés par le cardinal de Richelieu : les quatre autres étaient Corneille, Boisrobert (1592-1662), Claude de l’Estoile (1597-1652) et Guillaume Collet (1598-1659). Rotrou a écrit des comédies, des tragi-comédies, et des tragédies.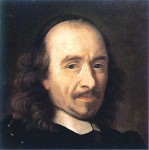 Né à Rouen le 6 juin 1606, Pierre Corneille qui mourut doyen de l’Académie le 1er octobre 1684 à Paris, donna au théâtre trente-trois pièces, tragédies mais aussi comédies, dont les sujets sont empruntés aux époques et aux histoires les plus diverses, ce qui lui valut d’être surnommé « le Grand Corneille » et « le Père de la Tragédie ». Pour certains il est même le créateur de la tragédie française, car avant lui celle-ci était un poème sans vie ou une œuvre désordonnée. Il fut aussi le premier à avoir enfermé un drame humain et vivant dans un cadre régulier.
Né à Rouen le 6 juin 1606, Pierre Corneille qui mourut doyen de l’Académie le 1er octobre 1684 à Paris, donna au théâtre trente-trois pièces, tragédies mais aussi comédies, dont les sujets sont empruntés aux époques et aux histoires les plus diverses, ce qui lui valut d’être surnommé « le Grand Corneille » et « le Père de la Tragédie ». Pour certains il est même le créateur de la tragédie française, car avant lui celle-ci était un poème sans vie ou une œuvre désordonnée. Il fut aussi le premier à avoir enfermé un drame humain et vivant dans un cadre régulier.