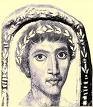 Plus jeune que Lucrèce, Catulle naquit à Vérone dans une famille qui devait tenir un rang dans sa province, puisque son père donnait l’hospitalité de sa maison à César quand celui-ci passait par là. Pour cette raison il bénéficia d’une éducation soignée ce qui lui permit de rencontrer, dès sa venue à Rome, les hommes les plus distingués par la naissance ou par l’esprit, notamment l’historien Cornelius Népos (100- vers 29 av. J.C.), les poètes Helvius Cinna (100-44 av. J.C.) le tribun de la plèbe, Calvus et Cornificius, mais aussi des hommes politiques comme Caton d’Utique (95-46 av. J.C.) et Cicéron. Il aimait la vie élégante, passant pour quelqu’un d’insouciant, indifférent à tout ce qui était commun ou médiocre, bref un dandy comme nous dirions aujourd’hui. En fait son insouciance devait être assimilé à de la paresse car il n’avait aucun goût pour le travail, et il eut tôt fait de dépenser la petite fortune que sa famille lui avait léguée.
Plus jeune que Lucrèce, Catulle naquit à Vérone dans une famille qui devait tenir un rang dans sa province, puisque son père donnait l’hospitalité de sa maison à César quand celui-ci passait par là. Pour cette raison il bénéficia d’une éducation soignée ce qui lui permit de rencontrer, dès sa venue à Rome, les hommes les plus distingués par la naissance ou par l’esprit, notamment l’historien Cornelius Népos (100- vers 29 av. J.C.), les poètes Helvius Cinna (100-44 av. J.C.) le tribun de la plèbe, Calvus et Cornificius, mais aussi des hommes politiques comme Caton d’Utique (95-46 av. J.C.) et Cicéron. Il aimait la vie élégante, passant pour quelqu’un d’insouciant, indifférent à tout ce qui était commun ou médiocre, bref un dandy comme nous dirions aujourd’hui. En fait son insouciance devait être assimilé à de la paresse car il n’avait aucun goût pour le travail, et il eut tôt fait de dépenser la petite fortune que sa famille lui avait léguée.
Lié avec l’influent Memmius (mort vers l’an 61 av. J.C.), Catulle pensait qu’en le suivant dans la province de Bythinie (Pont-Euxin) où Memmius venait d’être nommé gouverneur, il pourrait sortir de ses embarras financier. Hélas pour lui, Memmius ne fut pas aussi généreux qu’il l’espérait, et en plus Catulle ne savait pas compter. Il revint donc à Rome ruiné, ce qui lui fit dire : « Ma villa n’est exposée ni au souffle de l’Auster, ni à celui du Zéphire ou du cruel Borée, mais à quinze mille deux cent sesterces hypothéqués sur elle. Oh !le vent horrible ! Oh !le vent de peste ! ». En outre il perdit son frère en Asie Mineure, ce qui contribua à le rendre détaché des choses de la vie, et participa sans doute à l’altération de sa santé, fragilisée par les excès de toutes sortes qui peuplèrent son existence à défaut de l’égayer vraiment. On n’oubliera pas non plus sa liaison sulfureuse avec Clodia, la femme de Quintus Metellus, aussi belle que peu vertueuse, peut-être même empoisonneuse célèbre. Finalement il mourut très jeune, dans sa trente-troisième année, au moment où son talent s’exprimait dans tout son éclat.
L’œuvre de Catulle tient tout entière en un mince volume. Il s’agit d’un recueil de pièces très différentes d’inspiration et de mètre, et dont les unes, les plus longues, imitées des poètes alexandrins, ressemblent à des études, tandis que les autres (épigrammes, élégies, odes) lui sont suggérées par sa propre vie, exprimant entre autres ses amours et ses haines, peignant aussi ses divertissements et ses ennuis. Ses modèles par goût, par l’inclination d’un talent plus délicat que vigoureux, par son habileté technique, nous les trouvons parmi les Alexandrins. Peut-être aussi comme La Fontaine beaucoup plus tard, sa paresse naturelle ne prédisposait pas Catulle à écrire de longs ouvrages. Mais ces œuvres courtes étaient infiniment soignées avec peu de matière et beaucoup d’art.
Catulle en effet a toujours prêché le culte de « l’art pour l’art », tournant le dos aux auteurs nationaux comme Plaute ou Lucilius. C’est ainsi qu’il traduisit l’élégie de Callimaque sur la Chevelure de Bérénice. De même, bien que son inspirateur soit inconnu, il ne fait pas de doute que le poème sur Atys et l’Epithalame de Thétis et de Pélée ont une origine alexandrine. La justesse de l’expression, le souci du détail, la science du rythme, permettent de dire que l’auteur se situe sur ce plan très au-dessus de Lucrèce, aux vers trop souvent gauches et massifs. Mais Catulle est aussi un poète ardent et sincère, que ses propres émotions remuent au tréfonds de lui-même.
A côté des imitations de l’école d’Alexandrie, il y a aussi dans son recueil toute une série d’aimables pièces dans lesquelles Catulle nous livre son âme avec une grande sincérité, où l’on retrouve la fameuse Clodia (sans doute la sœur du démagogue Clodius) qu’il appelle Lesbie dans ses vers, qui le trompa et l’humilia tant et plus. « J’aime et je hais à la fois dit-il. Comment cela ? Je ne sais, mais je le sens et j’en ai l’âme torturée ». Cette indigne passion ne le dessécha pas pour autant, comme en témoigne sa douleur quand il perdit son frère, qu’il pleura dans des vers pleins de sanglots et de sensibilité. Doux et naïf de cœur, il fut en même temps d’esprit très indépendant, voire même parfois irritable. Ainsi César lui-même eut droit à des épigrammes peu amènes, ce dont le dictateur ne lui tint pas rigueur, n’ayant perçu chez Catulle que son talent, donc aucune ambition ni envie. Et de fait sa philosophie était simplement de se laisser aller à ses penchants, bornant son horizon au cercle de ses amis et de ses familiers.
On ne saurait trouver meilleur guide que lui si l’on veut connaître ce monde de gens d’esprit, escortés des inévitables et insupportables amateurs de littérature, le monde au milieu duquel il vécut avec ses talents, mais aussi ceux que l’on appellera plus tard « les fats ». En tout cas Catulle était plutôt un génial auteur, dont les vers passionnés font pressentir Virgile (70-19 av. J.C.), alors que les tableaux de genre annoncent l’arrivée d’Horace (75-8 av. J.C.). Tout dans son œuvre ne peut qu’appartenir à un artiste achevé, même si certains lui ont reproché des répétitions qui sollicitent trop l’attention, des diminutifs dont la grâce ne va pas sans mignardise. Mais le plus souvent on admire l’habileté à choisir le trait caractéristique qui touche et qui pénètre. Il y a même dans ses pièces des souvenirs de poètes familiers, mais ceux-ci prennent eux-mêmes une couleur personnelle, car Catulle les emploie avec une telle opportunité qu’ils semblent nécessaires là où ils sont. Ce n’est d’ailleurs pas là sa moindre gloire, puisque ainsi il fait prévoir l’art de la grande époque classique.
Michel Escatafal
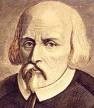 Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) est le grand poète dramatique de la seconde partie du Siècle d’Or. Né à Madrid d’une famille noble castillane, il fit ses études à Madrid et à Salamanque où il fit représenter à l’âge de vingt ans ses premiers essais dramatiques. Soldat comme Cervantes, il passa plusieurs années en Italie et en Flandre. Prêtre comme Lope de Vega, il fut chapelain honoraire du roi sans pour cela abandonner jamais le théâtre. Mort en 1681, il fut le vrai contemporain de Corneille.
Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) est le grand poète dramatique de la seconde partie du Siècle d’Or. Né à Madrid d’une famille noble castillane, il fit ses études à Madrid et à Salamanque où il fit représenter à l’âge de vingt ans ses premiers essais dramatiques. Soldat comme Cervantes, il passa plusieurs années en Italie et en Flandre. Prêtre comme Lope de Vega, il fut chapelain honoraire du roi sans pour cela abandonner jamais le théâtre. Mort en 1681, il fut le vrai contemporain de Corneille.
 Dans un précédent billet j’ai longuement parlé de Lope de Vega, mais il ne fut pas le seul grand poète de son époque. D’ailleurs certains n’hésitent pas à affirmer que Fray Gabriel Tellez (1584-1648), moine espagnol connu du grand public sous le nom de Tirso de Molina, peut soutenir la comparaison avec Lope de Vega dont il subit l’influence, ce qui n’enlève rien à son originalité. Quasiment aussi remarquable poète que Lope, théoricien et défenseur de la comédie dans Los cigarrales de Toledo, c’était un auteur dramatique de tout premier ordre, moins ingénieux que Lope mais parfois plus audacieux.
Dans un précédent billet j’ai longuement parlé de Lope de Vega, mais il ne fut pas le seul grand poète de son époque. D’ailleurs certains n’hésitent pas à affirmer que Fray Gabriel Tellez (1584-1648), moine espagnol connu du grand public sous le nom de Tirso de Molina, peut soutenir la comparaison avec Lope de Vega dont il subit l’influence, ce qui n’enlève rien à son originalité. Quasiment aussi remarquable poète que Lope, théoricien et défenseur de la comédie dans Los cigarrales de Toledo, c’était un auteur dramatique de tout premier ordre, moins ingénieux que Lope mais parfois plus audacieux. Parmi la galaxie brillante des poètes du Siècle d’Or, il y en a un qui a une place à part, Lope Felix de Vega Carpio (1562-1635), à la fois le plus doué et le plus fécond de tous.
Parmi la galaxie brillante des poètes du Siècle d’Or, il y en a un qui a une place à part, Lope Felix de Vega Carpio (1562-1635), à la fois le plus doué et le plus fécond de tous.