Mais au fait qui étaient ces dieux ? Et bien, c’était une véritable armée céleste avec des généraux, des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang. Le plus gradé si j’ose dire était Jupiter (dieu du ciel), mais il n’était pas le roi comme Zeus chez les Grecs. Certains dirent qu’il ne fit qu’un avec Janus, le dieu des portes, à une époque très ancienne. Mars (dieu de la guerre) était d’un rang quasiment égal, d’autant qu’il était le père naturel de Romulus. Il a eu droit à un mois de l’année à son nom. Saturne aussi était un dieu influent, puisqu’il était le dieu des semailles, très importantes dans l’antiquité. Ensuite il y avait les déesses, notamment Junon, la déesse du mariage et de la fertilité. Elle aussi a eu droit à un mois à son nom, le mois de juin. Minerve (déesse de l’intelligence), importée de Grèce, protégeait la sagesse et la science. Vénus, c’était évidemment la beauté et l’amour, et Diane, déesse de la Lune, s’occupait plus particulièrement de la chasse, mais aussi des bois. Son mari, Virbius, s’occupait lui des forêts.
Les autres étaient des officiers ou même des sous-officiers, comme Hercule, dieu du vin et de la gaieté. Mercure (dieu du commerce et de l’éloquence), avait évidemment un faible pour les marchands, les orateurs et même les voleurs, ce qui parfois signifiait la même chose. Bellone, épouse de Mars, s’occupait plus particulièrement de la guerre. Voilà pour les principaux dieux, mais en réalité ils furent très nombreux. Ils le furent d’autant plus, qu’après chaque victoire les soldats faisaient main basse sur les dieux des pays conquis. Les Romains étaient accueillants pour les divinités, au point de leur assigner un poste dans l’Olympe ! En 496 av. J.C., Demeter et Dyonisos furent engagés comme collaborateurs de Cérès (déesse des moissons) et Liber (dieu du vin). Castor et Pollux furent aussi consacrés protecteurs de Rome, car ils aidèrent les Romains à l’emporter sur les Latins qui soutenaient les Tarquins (496 av. J.C.). Vers 300 av. J.C., Esculape déménagea à Rome pour y enseigner la médecine. En fait tout ceci était la manifestation de l’influence grecque qui devenait de plus en plus importante.
Cela dit, au fur et à mesure que le temps passait, les dieux se multipliaient tellement que Pétrone (14-66), l’auteur supposé du Satyricon, disait que dans certaines villes, il y en avait davantage que d’habitants. Chez les plus grands écrivains comme Horace (65-8 av. J.C.), Tibulle (54-19 av. J.C.), Virgile (70-19 av. J.C.) et Lucain (39-65), neveu de Sénèque (4 av. J.C. – 65), on en rencontre partout. Varron pour sa part en décomptait au moins trente mille, et contrairement à l’image que l’on se fait aujourd’hui de Dieu, ils étaient partout, et en plus ils étaient en proie aux excitations terrestres (luxure, cupidité, envie etc.), ce qui les rendait d’autant plus redoutables. Alors pour mettre les hommes à l’abri de leurs méfaits on multiplia les ordres ou collèges religieux.
Il y eut même un ordre féminin, celui des Vestales (Vestale était la mère de Romulus), ancêtres de nos religieuses, qui étaient recrutées entre six et dix ans, et qui devaient faire trente ans de service dans une chasteté absolue. Vêtues de blanc, elles passaient leur temps à arroser la terre avec de l’eau provenant d’une fontaine consacrée à la nymphe Egérie, entretenant le foyer de la Cité, personnifié par la déesse Vesta (foyer). Evidemment toute incartade leur était interdite sous peine des plus cruels châtiments, pouvant aller jusqu’à être enterrées vives, ce qui est arrivé plus d’une dizaine de fois si l’on en croit ce qui est rapporté par les historiens romains. En revanche, une fois leur service trentenaire achevé, elles retrouvaient la société avec honneurs et privilèges, pouvant même se marier ce qui, toutefois, n’était pas si facile compte tenu de leur âge presque canonique pour l’époque.
Outre les Vestales, il y eut aussi les douze Saliens voués au culte de Mars, et les vingt Féciaux qui constituaient le collège des diplomates. Ils exécutaient les rites de déclaration de guerre et de conclusion des traités. Tous ces gens formaient le service des dieux de la Cité. Il y avait aussi le service des dieux de la nature avec les douze Luperques qui, chaque année, exécutaient en février des rites magiques pour défendre les bergeries contre les loups. Ils organisaient aussi les Fêtes de la Fécondité (Lupercalia) à la gloire du dieu Lupercus (loup-cervier). Quant aux douze Arvales, constitués à l’origine par les douze fils du berger Faustulus, ils célébraient tous les ans (en mai) dans un bois sacré près de Rome une cérémonie en l’honneur de Cérès, la terre nourricière. Enfin à côté des Augures, au nombre de six (deux par tribu) sous Tarquin l’Ancien ( roi de 616 à 579 av. J.C.), qui étaient des experts pour l’interprétation des signes célestes, il y avait aussi des prêtres d’un rang inférieur, les Haruspices, qui n’étaient que de vulgaires charlatans étudiant les entrailles des victimes sacrifiés pour en déduire des présages.
Toutefois la religion avait d’autres vertus pour les Romains que des rites plus ou moins folkloriques, car c’est elle qui allait permettre de déterminer les jours de fête et de repos, les Romains ignorant les dimanches et encore plus les week-ends. Il y avait dans l’année une centaine de ces jours-là, ce qui correspond en gros à nos jours ouvrables. Ces jours de fête ou de repos étaient célébrés le plus souvent avec beaucoup de sérieux, certains étant commémoratifs, tels les lémures (jour des morts) au mois de mai, qui donnaient lieu à un cérémonial ordonnancé par le père de famille à base de haricots blancs, mis dans la bouche puis recrachés. En février il y avait les parentales et les lupercales, au cours desquelles on jetait dans le Tibre des petites poupées en bois, ce qui permettait de tromper le dieu qui réclamait des hommes. Il y avait aussi les floralies, les libérales ou encore les saturnales, fêtes au cours desquelles on pouvait faire à peu près tout ce qu’on voulait pourvu qu’on restât dans la légalité.
Mais là aussi c’était surtout l’anarchie qui régnait, ce qui obligea très tôt les Romains à confectionner un calendrier pour établir la liste de ces fêtes. La tradition attribue à Numa Pompilius (715-672 av. J.C., deuxième roi de Rome) d’avoir établi un calendrier fixe de 355 jours (douze mois lunaires), avant qu’il ne soit remplacé par celui de César (en 46 av. J.C.) qui instituait l’année de 365-366 jours, ce qui n’était pas un luxe compte tenu du fait que les pontifes avaient tellement abusé des jours intercalaires que les fêtes des moissons ne tombaient plus en été, ni celle des vendanges en automne. C’était aussi comme si on passait à autre chose, puisque la morale divine qui avait longtemps guidé Rome était en train de s’évanouir. D'ailleurs, malgré une apparence de bien être à Rome et dans l’empire, avec une monnaie assainie, une bureaucratie qui fonctionnait, une armée à la fois forte et puissante, la réforme des mœurs qu’Auguste avait essayé d’initier a échoué.
Certains dirent que le divorce et le malthusianisme avaient anéanti la famille, et que la souche romaine était presque éteinte, car les trois quarts des citoyens étaient des affranchis ou des fils d’affranchis étrangers. On avait construit de nombreux temples nouveaux, mais à l’intérieur il n’y avait plus que des dieux auxquels plus personne ne croyait, mais comme on le pensait encore chez nous au siècle précédent, on ne refait pas une morale sans base religieuse. La preuve, malgré la volonté d’Auguste de ranimer la foi de jadis, le peuple lui répondit en l’adorant comme un dieu, ou plutôt en faisant semblant de l’adorer, comme une sorte de délégué des dieux.
Cicéron lui-même n’avait-il pas admis en son temps que « par les mœurs et la coutume générale des hommes éminents, par leurs bienfaits, il était logique qu'ils fussent élevés au ciel », même si en disant cela il ne pensait pas à un roi, contrairement à Horace, Virgile ou Ovide qui voyaient Auguste prendre place parmi les étoiles dans l’au-delà, comme les dieux normaux d’autrefois. Mais comme toute société ne peut vivre sans religion, le christianisme va peu à peu remplacer les multiples dieux du temps passé, par un autre dont la particularité est qu’il est un seul Dieu en trois personnes. Hélas le christianisme va permettre la constitution d’une société ou d’un régime politique à visée totalitaire, rendu nécessaire dans un premier temps par la survie de l’institution impériale romaine, puis plus tard comme chez nous (en France et en Europe) de l’institution royale.
Michel Escatafal
 Né à Dreux (en 1609) d’une famille de magistrats, Jean Rotrou eut une vie assez échevelée. Avocat sans pratique, il fut en fait un professionnel de l’écriture, vivant du produit de ses pièces. Il n’avait pas 20 ans quand il fit représenter sa première comédie, l’Hypocondriaque, tragi-comédie dont s’inspirera Goethe pour son opérette Lila. Il fit partie de la Compagnie des cinq auteurs chargés de développer les canevas dramatiques inventés par le cardinal de Richelieu : les quatre autres étaient Corneille, Boisrobert (1592-1662), Claude de l’Estoile (1597-1652) et Guillaume Collet (1598-1659). Rotrou a écrit des comédies, des tragi-comédies, et des tragédies.
Né à Dreux (en 1609) d’une famille de magistrats, Jean Rotrou eut une vie assez échevelée. Avocat sans pratique, il fut en fait un professionnel de l’écriture, vivant du produit de ses pièces. Il n’avait pas 20 ans quand il fit représenter sa première comédie, l’Hypocondriaque, tragi-comédie dont s’inspirera Goethe pour son opérette Lila. Il fit partie de la Compagnie des cinq auteurs chargés de développer les canevas dramatiques inventés par le cardinal de Richelieu : les quatre autres étaient Corneille, Boisrobert (1592-1662), Claude de l’Estoile (1597-1652) et Guillaume Collet (1598-1659). Rotrou a écrit des comédies, des tragi-comédies, et des tragédies.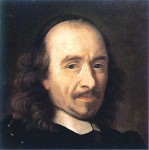 Né à Rouen le 6 juin 1606, Pierre Corneille qui mourut doyen de l’Académie le 1er octobre 1684 à Paris, donna au théâtre trente-trois pièces, tragédies mais aussi comédies, dont les sujets sont empruntés aux époques et aux histoires les plus diverses, ce qui lui valut d’être surnommé « le Grand Corneille » et « le Père de la Tragédie ». Pour certains il est même le créateur de la tragédie française, car avant lui celle-ci était un poème sans vie ou une œuvre désordonnée. Il fut aussi le premier à avoir enfermé un drame humain et vivant dans un cadre régulier.
Né à Rouen le 6 juin 1606, Pierre Corneille qui mourut doyen de l’Académie le 1er octobre 1684 à Paris, donna au théâtre trente-trois pièces, tragédies mais aussi comédies, dont les sujets sont empruntés aux époques et aux histoires les plus diverses, ce qui lui valut d’être surnommé « le Grand Corneille » et « le Père de la Tragédie ». Pour certains il est même le créateur de la tragédie française, car avant lui celle-ci était un poème sans vie ou une œuvre désordonnée. Il fut aussi le premier à avoir enfermé un drame humain et vivant dans un cadre régulier. Pour les anciens, Varron fut un personnage tout aussi considérable que Cicéron, au point que ses contemporains le surnommèrent « le plus savant des Romains ». Hélas pour lui, et plus encore pour nous, il ne reste qu’une très faible partie de ses ouvrages, mais cela suffit pour montrer qu’il appartenait vraiment à cette génération qui sut encore concilier la grande culture littéraire et l’activité civique.
Pour les anciens, Varron fut un personnage tout aussi considérable que Cicéron, au point que ses contemporains le surnommèrent « le plus savant des Romains ». Hélas pour lui, et plus encore pour nous, il ne reste qu’une très faible partie de ses ouvrages, mais cela suffit pour montrer qu’il appartenait vraiment à cette génération qui sut encore concilier la grande culture littéraire et l’activité civique.