 Neveu du poète Philippe Desportes (frère de sa mère), Mathurin Régnier est né à Chartres en 1573 et mort en 1613. Entré dans les ordres, il fut par deux fois attaché à ‘ambassade de France à Rome. Cela dit son humeur indépendante ne put se plier à aucune servitude et l’entraîna irréductiblement vers la poésie. Il s’y livra d’ailleurs tout entier quand, après son retour en France, il eut obtenu une pension de deux mille livres sur l’abbaye des Vaux-de-Cernay (entre Chevreuse et Rambouillet), qui avait appartenu à son oncle (1606), et un canonicat à la cathédrale de Chartres (1609).
Neveu du poète Philippe Desportes (frère de sa mère), Mathurin Régnier est né à Chartres en 1573 et mort en 1613. Entré dans les ordres, il fut par deux fois attaché à ‘ambassade de France à Rome. Cela dit son humeur indépendante ne put se plier à aucune servitude et l’entraîna irréductiblement vers la poésie. Il s’y livra d’ailleurs tout entier quand, après son retour en France, il eut obtenu une pension de deux mille livres sur l’abbaye des Vaux-de-Cernay (entre Chevreuse et Rambouillet), qui avait appartenu à son oncle (1606), et un canonicat à la cathédrale de Chartres (1609).
Outre un petit nombre de poésies diverses, épîtres, élégies, odes, épigrammes, poésies spirituelles, il a laissé seize satires qui lui assurent l’immortalité. A ce propos Boileau dit de lui, dans sa cinquième réflexion sur Longin, qu’il est " le poète français qui, du consentement de tout le monde, a le mieux connu, avant Molière, les mœurs et le caractère des hommes ". Ajoutons que sa langue, parfois embarrassée dans ses constructions, abonde en expressions pittoresques et d’un coloris populaire archaïque.
La liberté ordinaire de ses allures ne pouvait lui permettre de s’accommoder des réformes impérieuses de Malherbe, ce qui l’amena à s’ériger en face de lui en défenseur de la Pléiade. Mais la postérité doit reconnaître que leur humeur, plus que leurs principes, dut être entre ces deux grands poètes une cause de division, et que Régnier se trompait lui-même quand, avec sa franchise robuste, parfois même brutale, son air naturel et dégagé, il se croyait encore le représentant d’une école dont les poésies, ou savantes, ou mignardes, et souvent d’une forme remarquable, ne sont assurément rien moins que dénuées d’affectation.
J’ai retenu dans son œuvre deux satires qui sont sans doute les plus caractéristiques du style et de la pensée de Régnier. Dans la satire III, il s’adresse à Monsieur le Marquis de Coeuvres lui demandant ce qu’il doit faire, étant " las de courir ", et notamment s’il se remet de nouveau à " l’estude ". A noter pour l’anecdote que ce marquis de Coeuvres (1575-1670), deviendra maréchal de France en 1623. Quant au fait de " courir ", il faut savoir que Mathurin Régnier, après avoir suivi à Rome le cardinal de la Joyeuse, s’était attaché au service de Philippe de Béthune, beau-frère du marquis de Coeuvres et ambassadeur d’Henri IV dans cette même ville de Rome. Toujours dans cette satire, j’ai découvert que Régnier parle des " mignons, fils de la poule blanche ", ce qui est une traduction d’une expression proverbiale latine que Juvénal emploie ironiquement dans le sens de " gens privilégiés par leur naissance, hommes qui ne sont pas du commun ".
Dans la satire IX Régnier s’en prend à Malherbe et aux poètes de son école, en s’adressant à Monsieur Rapin qui n’était autre que le poète Nicolas Rapin (1535-1608), l’un des auteurs de la Satire Ménipée. Sa critique à Malherbe porte surtout sur le fait que Malherbe n’aimait pas du tout les Grecs, comme en témoigne le fait qu’il " s’était déclaré ennemi du galimatias de Pindare ". Régnier contrairement à son meilleur ennemi, ne voulait pas nécessairement que l’on abandonnât systématiquement les emprunts au grec et au latin. La preuve, quelques pages plus loin, on trouve cette phrase : "Et laissant là Mercure (dieu du commerce) et toutes ses malices, les nonchalances sont ses plus grands artifices ". Enfin j’ai découvert que c’est Régnier qui aura remis au goût du jour l’expression d’Horace " mêler l’utile à l’agréable", que Régnier a traduit : "Qu’ils auront joint l’utile avecq’ le delectable ". Régnier avait quand même beaucoup de talent, et il mérite amplement la belle place qu’il a dans notre littérature.
Michel Escatafal
 Né à Paris vers 1570, mort de la peste vers 1632, Alexandre Hardy est le plus célèbre des auteurs dramatiques des premières années du dix-septième siècle. Aujourd’hui nous dirions plutôt qu’il fut avant tout un auteur à succès. Attaché comme poète à une troupe de comédiens qui, sans renoncer définitivement à parcourir la province, s’était établie à Paris en 1607, il fit preuve d’une incroyable fécondité, puisqu’il se vante d’avoir composé plus de six cents pièces, tragédies, tragi-comédies et pastorales, dont il a publié quarante et une.
Né à Paris vers 1570, mort de la peste vers 1632, Alexandre Hardy est le plus célèbre des auteurs dramatiques des premières années du dix-septième siècle. Aujourd’hui nous dirions plutôt qu’il fut avant tout un auteur à succès. Attaché comme poète à une troupe de comédiens qui, sans renoncer définitivement à parcourir la province, s’était établie à Paris en 1607, il fit preuve d’une incroyable fécondité, puisqu’il se vante d’avoir composé plus de six cents pièces, tragédies, tragi-comédies et pastorales, dont il a publié quarante et une. Né à Caen en 1555 dans une famille noble, mort à Paris en 1628, François de Malherbe qui étudia successivement à Caen, Paris, Bâle et Heidelberg, fut d’abord secrétaire du duc d’Angoulême, fils naturel d’Henri II, grand prieur de France, et gouverneur de Provence (1576-1587). Recommandé plus tard à Henri IV par le cardinal Du Perron et le poète normand Vauquelin des Yveteaux, fils de Vauquelin de la Fresnaye, il vint à Paris et fut attaché au service du duc de Bellegarde, grand écuyer, puis devint gentilhomme ordinaire de la Chambre, ce qui lui permit de continuer à bénéficier de la part de Marie de Médicis, régente, et du roi Louis XIII, des faveurs dont il avait joui auprès d’Henri IV.
Né à Caen en 1555 dans une famille noble, mort à Paris en 1628, François de Malherbe qui étudia successivement à Caen, Paris, Bâle et Heidelberg, fut d’abord secrétaire du duc d’Angoulême, fils naturel d’Henri II, grand prieur de France, et gouverneur de Provence (1576-1587). Recommandé plus tard à Henri IV par le cardinal Du Perron et le poète normand Vauquelin des Yveteaux, fils de Vauquelin de la Fresnaye, il vint à Paris et fut attaché au service du duc de Bellegarde, grand écuyer, puis devint gentilhomme ordinaire de la Chambre, ce qui lui permit de continuer à bénéficier de la part de Marie de Médicis, régente, et du roi Louis XIII, des faveurs dont il avait joui auprès d’Henri IV. Né à Falaise (Calvados)
Né à Falaise (Calvados) 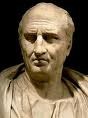 Les Romains ont toujours prétendu que la satire faisait partie de leur identité nationale. D’abord le nom même de satire est purement latin, satura étant un adjectif qui, employé substantivement, signifie mélange.
Les Romains ont toujours prétendu que la satire faisait partie de leur identité nationale. D’abord le nom même de satire est purement latin, satura étant un adjectif qui, employé substantivement, signifie mélange.