 Les anciens ont fort peu parlé de Lucrèce, au point que les renseignements sur sa vie nous font presque complètement défaut. A peine sait-on qu’il naquit à Rome d’une famille riche d’origine noble un peu avant l’an 100 av. J.C., mais le mystère qui enveloppe sa naissance et même sa vie tout court plane aussi sur sa mort que l’on situe en 55 av. J.C., date à laquelle il se serait suicidé en se perçant de sa propre main, comme le rapporte Saint-Jérôme. Toutefois nous savons qu’il se consacra entièrement à l’étude et à la poésie, et que la postérité n’a retenu de lui que son poème intitulé De Rerum Natura ou si l’on préfère en français de la Nature, publiée sans doute par Cicéron.
Les anciens ont fort peu parlé de Lucrèce, au point que les renseignements sur sa vie nous font presque complètement défaut. A peine sait-on qu’il naquit à Rome d’une famille riche d’origine noble un peu avant l’an 100 av. J.C., mais le mystère qui enveloppe sa naissance et même sa vie tout court plane aussi sur sa mort que l’on situe en 55 av. J.C., date à laquelle il se serait suicidé en se perçant de sa propre main, comme le rapporte Saint-Jérôme. Toutefois nous savons qu’il se consacra entièrement à l’étude et à la poésie, et que la postérité n’a retenu de lui que son poème intitulé De Rerum Natura ou si l’on préfère en français de la Nature, publiée sans doute par Cicéron.
Cette œuvre divisée en six livres, dont le dernier paraît inachevé, est l’exposé du système du monde d’après la physique d’Epicure (342-270 av. J.C.), empruntée à Leucippe et Démocrite qui vécurent deux cents ans avant lui. Cette philosophie à la fois très aride et très simple est exposée avec une belle rigueur par Lucrèce. On peut la résumer en disant que la matière est éternelle, que rien ne naît de rien, et que rien ne retourne au néant. Tout cela évidemment ne pouvait pas plaire aux esprits religieux, et notamment aux penseurs chrétiens, ce qui explique qu’il fallut attendre Montaigne et plus tard les philosophes du dix-huitième siècle pour qu’on le redécouvrît.
Mais que peut-on dire de la poésie de Lucrèce ? Tout d’abord dans son poème l’impression qui ressort dès le début de la lecture est la tristesse, ce qui ne correspond pas au système épicurien fait d’une sagesse souriante. Pour Lucrèce l’homme est marqué dès sa naissance pour le malheur, comme en témoignent ces mots : « le nouveau-né semblable au nautonier jeté sur le rivage par la fureur de la mer, gît à terre, nu, sans langage, dénué de tout ce que la vie réclame…il remplit l’espace de vagissements lamentables, et c’est justice : il lui reste tant de maux à traverser dans le cours de la vie ». De plus, de quelque côté que l’homme se tourne, partout la souffrance se présente à lui, « les saisons nous apportent les maladies, la mort vague au hasard et vient sans être attendue ». On voit que le poète vivait dans une société troublée, comme c’était le cas à son époque à Rome !
Cela dit, de cette désolation naît dans l’âme de Lucrèce la pitié pour tous ces malheureux à qui on ne sait quelle consolation leur offrir. La religion ? Certainement pas car cette religion est une des causes de leurs malheurs, ajoutant à leurs maux trop réels des maux imaginaires. Pour Lucrèce « le genre humain gît honteusement écrasé sous le poids de la superstition, monstre dont la tête apparaît dans les régions célestes, et dont l’affreux regard terrifie les mortels ». En fait le poète poursuit un but à la fois noble et généreux, « cherchant les mots et les vers qui seuls peuvent offrir à l’esprit une clarté lumineuse ». Cet amour pour l’humanité douloureuse donne à sa poésie un accent de tendresse grave, et imprime à son œuvre un caractère d’indignation sincère et passionnée. Sa logique n’est pas celle froide des physiciens et des géomètres, mais vient du cœur.
Pour Lucrèce, délivrer les âmes de la crainte des dieux et de la mort rendra aux hommes plus de sérénité, et leur permettra de jouir enfin d’un repos auquel ils n’osent même plus aspirer y compris à travers les plaisirs les plus simples : « Etendus avec vos amis sur le frais gazon, près d’une source pure, sous le feuillage d’un arbre élevé, vous apaiserez agréablement votre faim, à l’heure où la saison sourit et où le printemps sème de fleurs la verte prairie ». Toutefois, ce n’est pas pour cela qu’il se contentera d’en rester là, à la manière d’un Epicure qui professe l’indifférence pour les problèmes. Au contraire Lucrèce a été bien plus loin que son maître dans l’intelligence du monde. Il veut voir les choses comme elles sont, trouvant même une beauté dans leur tristesse.
La science a pris l’imagination du poète autant que sa raison. Elle évoque des tableaux grandioses, la naissance et la mort des mondes, l’éternel bouillonnement de la vie. Néanmoins Lucrèce a beau concevoir le monde comme une immense machine, il est pénétré par la vie obscure qui anime les êtres et les choses. Philosophe, il veut comprendre et savoir, mais il est poète avant tout et sa sensibilité a plus de chaleur que son intelligence n’a de lumière. Il prête à la nature des colères et des tendresses, des douleurs et des joies, ce qu’il exprime en disant que « la mer a des perfidies et des sourires, les bois ont une voix et des chants, et les vents des rages furieuses ». ». Lucrèce connaît la nature et l’aime.
Bien entendu, le style de Lucrèce est très dépendant de cette forme de tristesse de l’âme et de ses pensées tellement austères. Il est sobre, vigoureux et grave, soucieux de précision, mais jamais de l’élégance. En fait il ne montre de la flamme et de la passion que lorsqu’il parle des religions qu’il exècre, comme je l’ai montré auparavant. Plus généralement, il sait aussi être émouvant quand il évoque la vie tout simplement, ce qui a fait dire à certains que « Lucrèce ne chante pas la Nature, mais qu’elle se chante dans ses vers ». Son modèle en matière de versification fut Ennius, ne cherchant pas le rythme et l’harmonie, ce qui ne l’empêche pas d’atteindre parfois une certaine magnificence. Bref, Lucrèce est sans nul doute le poète le plus original de la littérature latine, même s’il n’appartient pas à ce que l’on appelle la littérature classique.
Michel Escatafal
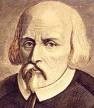 Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) est le grand poète dramatique de la seconde partie du Siècle d’Or. Né à Madrid d’une famille noble castillane, il fit ses études à Madrid et à Salamanque où il fit représenter à l’âge de vingt ans ses premiers essais dramatiques. Soldat comme Cervantes, il passa plusieurs années en Italie et en Flandre. Prêtre comme Lope de Vega, il fut chapelain honoraire du roi sans pour cela abandonner jamais le théâtre. Mort en 1681, il fut le vrai contemporain de Corneille.
Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) est le grand poète dramatique de la seconde partie du Siècle d’Or. Né à Madrid d’une famille noble castillane, il fit ses études à Madrid et à Salamanque où il fit représenter à l’âge de vingt ans ses premiers essais dramatiques. Soldat comme Cervantes, il passa plusieurs années en Italie et en Flandre. Prêtre comme Lope de Vega, il fut chapelain honoraire du roi sans pour cela abandonner jamais le théâtre. Mort en 1681, il fut le vrai contemporain de Corneille.
 Dans un précédent billet j’ai longuement parlé de Lope de Vega, mais il ne fut pas le seul grand poète de son époque. D’ailleurs certains n’hésitent pas à affirmer que Fray Gabriel Tellez (1584-1648), moine espagnol connu du grand public sous le nom de Tirso de Molina, peut soutenir la comparaison avec Lope de Vega dont il subit l’influence, ce qui n’enlève rien à son originalité. Quasiment aussi remarquable poète que Lope, théoricien et défenseur de la comédie dans Los cigarrales de Toledo, c’était un auteur dramatique de tout premier ordre, moins ingénieux que Lope mais parfois plus audacieux.
Dans un précédent billet j’ai longuement parlé de Lope de Vega, mais il ne fut pas le seul grand poète de son époque. D’ailleurs certains n’hésitent pas à affirmer que Fray Gabriel Tellez (1584-1648), moine espagnol connu du grand public sous le nom de Tirso de Molina, peut soutenir la comparaison avec Lope de Vega dont il subit l’influence, ce qui n’enlève rien à son originalité. Quasiment aussi remarquable poète que Lope, théoricien et défenseur de la comédie dans Los cigarrales de Toledo, c’était un auteur dramatique de tout premier ordre, moins ingénieux que Lope mais parfois plus audacieux.