Né au château de Fénelon le 6 août 1651, dans le Périgord, mort archevêque de Cambrai le 7 janvier 1715 ( la même année que Louis XIV), François de Salignac de la Mothe-Fénelon fut, après être sorti du séminaire de Saint-Sulpice, chargé de la direction d’une maison fondée pour recueillir les jeunes filles qui venaient d’abjurer le protestantisme, les Nouvelles Catholiques (1678-1688). C’est vers cette époque qu’il dut écrire, à la demande de la duchesse de Beauvilliers, son Traité de l’éducation des filles. En 1688, devenu précepteur du duc de Bourgogne, fils du Dauphin, il composa pour lui des Fables, des Dialogues des Morts, et probablement Télémaque, qui ne fut cependant pas achevé à cette époque.
Nommé en 1695 archevêque de Cambrai, Fénelon soutint de 1696 à 1699, contre Bossuet, une lutte ardente à propos du quiétisme (quies, repos) qui est, rappelons-le, une doctrine mystique suivant laquelle la perfection consiste moins pour l’âme chrétienne à agir qu’à s’absorber en Dieu. C’est à cette doctrine que paraissaient tendre les écrits de Madame Guyon (1648-1717) qui avait connu le succès en France auprès de quelques âmes d’élite, et dont Fénelon se constitua jusqu’à un certain point le défenseur.
En 1699, ses doctrines furent condamnées par le pape. Dès 1697, le roi l’avait relégué dans son diocèse après la publication furtive, et faite sans l’aveu de Fénelon, de Télémaque. Avec ce livre, rempli d’enseignements politiques qui n’étaient pas de nature à plaire à Louis XIV, sa disgrâce ne pouvait que se confirmer. Mais Fénelon n’est pas resté inactif pour autant, car dans toute cette période il a rédigé un grand nombre d’opuscules politiques et, surtout après la mort du grand dauphin (1711), se prépare pour le moment où montera sur le trône un prince façonné par ses mains, lorsque la mort du duc de Bourgogne (1712) vient ruiner toutes ses espérances, sans qu’il se désintéresse pour cela de la chose publique.
Des dernières années de sa vie datent deux ouvrages importants, le Traité de l’existence et des attributs de Dieu, et la Lettre à l’Académie ou Lettre sur les occupations de l’Académie française, et l’on publia encore après sa mort ses Dialogues sur l’Eloquence, qu’il doit avoir écrits dans la première partie de sa carrière littéraire. Le caractère de Fénelon gardera toujours aux yeux de la postérité quelque chose d’énigmatique, qui contraste singulièrement avec la solidité et la simplicité de l’âme et des principes d’un Bossuet. Cela dit, qu’on se sente attiré vers lui par ce qu’il y eut de charmant et assurément de généreux dans son esprit, ou qu’on soit plus frappé de ce qu’il y eut souvent dans ses démarches de calculé et de peu net, on ne peut s’empêcher de lui reconnaître beaucoup d’indépendance dans le jugement.
Dans presque toutes les questions, en critique, en histoire, en politique, il a vu plus loin et avec plus de finesse que les écrivains qui l’ont précédé. Certes les philosophes du dix-huitième siècle ont pu, en le considérant comme une sorte de précurseur, se tromper sur les vraies tendances de la politique de Fénelon, qui fut surtout préoccupé d’assurer à la noblesse, dans l’intérêt de tout le peuple, une part effective au gouvernement de l’Etat, et peut-être sur son esprit de tolérance. Il leur ressemble, du moins par sa haine de tout despotisme sans frein et sans contrepoids, par son ardeur pour les réformes qu’il juge bienfaisantes, et l’on ne s’étonne qu’à moitié de l’espèce de popularité dont ont joui son souvenir et ses écrits aux approches et à l’époque de la Révolution.
Parmi ses écrits j’ai tout particulièrement retenu dans le Sermon pour la fête de l’Epiphanie, le passage sur la société de la fin du dix-septième siècle, époque où on voit la haute société, que la noblesse jusque-là composait presque toute seule, se mélanger d’un grand nombre de gens de finance et de bourgeois parvenus. Ce changement dans les mœurs sociales est d’ailleurs nettement marqué par La Bruyère (des Biens de fortune) et par les auteurs comiques du temps. Fénelon et tous ceux qui, comme lui, aspiraient à voir la noblesse reprendre dans l’Etat la place qu’elle y occupait avant Richelieu et Louis XIV, devaient en souffrir particulièrement. En outre dans ce sermon on retrouve, comme chez les autres prédicateurs de l’époque, une violente diatribe contre les grands seigneurs indélicats. Fénelon rappelle « que le dernier des devoirs est celui de payer ses dettes », ajoutant que « les prédicateurs n’osent plus parler pour les pauvres, à la vue d’une foule de créanciers dont les clameurs montent jusqu’au ciel ».
Fénelon sera presque aussi violent dans une lettre à Louis XIV, tellement dure à l’encontre du roi que certains en avaient presque contesté l’authenticité, et dans laquelle on trouve des phrases telles que celles-ci : "Vos peuples, que vous devriez aimer comme vos enfants, et qui ont été jusqu’ici si passionnés pour vous, meurent de faim". Puis un peu plus loin, Fénelon n’hésite pas écrire que « la France entière n’est plus qu’un grand hôpital désolé et sans provision. Les magistrats sont avilis et épuisés. La noblesse, dont tout le bien est en décret, ne vit que des lettres d’Etat ». A ce propos, il faut noter que le mot « décret » doit être traduit comme ordonnance de saisie, et que les « Lettres d’Etat » avaient pour effet de suspendre, pendant six mois, les procédures civiles dirigées contre les personnes employées au service de l’Etat. Cette lettre suffit à démontrer dans quel état se trouvait la France en 1695. Cela n’a pas empêché Louis XIV de se lancer deux ans plus tard dans la guerre de succession d’Espagne, qui durera jusqu’en 1713.
Michel Escatafal
 Jean de la Bruyère, né à Paris en août 1645 d’une famille bourgeoise de province, mort à Versailles en mai 1696, eut une vie très discrète sur laquelle nous n’avons que peu de renseignements. Tout au plus nous savons qu’il fit des études de droit à Orléans, et qu’il devint avocat au Parlement de Paris, sans que nous n’ayons trouvé nulle trace d’une quelconque plaidoirie. Ensuite il entra en 1684, sur la recommandation de Bossuet, dans la maison du grand Condé comme précepteur de son petit-fils. En 1688, il publia une médiocre traduction d’un recueil assez piquant, quoique dépourvu d’élévation morale, les Caractères du philosophe grec Théophraste (372-288 av. J.C.), le plus célèbre des disciples d’Aristote. Et cela lui donna l’idée d’écrire une suite d’observations et de portraits originaux, intitulés les Caractères ou les Mœurs de ce siècle.
Jean de la Bruyère, né à Paris en août 1645 d’une famille bourgeoise de province, mort à Versailles en mai 1696, eut une vie très discrète sur laquelle nous n’avons que peu de renseignements. Tout au plus nous savons qu’il fit des études de droit à Orléans, et qu’il devint avocat au Parlement de Paris, sans que nous n’ayons trouvé nulle trace d’une quelconque plaidoirie. Ensuite il entra en 1684, sur la recommandation de Bossuet, dans la maison du grand Condé comme précepteur de son petit-fils. En 1688, il publia une médiocre traduction d’un recueil assez piquant, quoique dépourvu d’élévation morale, les Caractères du philosophe grec Théophraste (372-288 av. J.C.), le plus célèbre des disciples d’Aristote. Et cela lui donna l’idée d’écrire une suite d’observations et de portraits originaux, intitulés les Caractères ou les Mœurs de ce siècle. 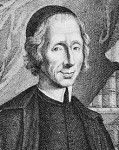 Né à Paris en 1638, la même année que Louis XIV, Nicolas Malebranche était d’une complexion délicate. Elevé d’abord dans sa famille et surtout par sa mère, il termina ses études au collège de la Marche (situé près de la place Maubert), puis suivit les cours de la faculté de théologie, et dès l’âge de vingt-deux ans il entra à l’Oratoire, avant d'être ordonné prêtre en 1664. Dès lors, toute sa vie fut consacrée à l’étude et à la méditation. Disciple de Descartes, en même temps qu’ardent chrétien, après avoir reconnu comme son maître la distinction de l’étendue et de la pensée, il dénie à la seconde comme à la première toute puissance active. Dieu seul est cause : cause de l’existence des êtres, cause de leurs modifications, cause enfin des idées que nous en formons, lesquelles ne pouvant ni émaner des corps, ni être créées par notre pensée, ne sont aperçues par nous qu’en Dieu : c’est là ce qu’on appelle la théorie de la vision de Dieu.
Né à Paris en 1638, la même année que Louis XIV, Nicolas Malebranche était d’une complexion délicate. Elevé d’abord dans sa famille et surtout par sa mère, il termina ses études au collège de la Marche (situé près de la place Maubert), puis suivit les cours de la faculté de théologie, et dès l’âge de vingt-deux ans il entra à l’Oratoire, avant d'être ordonné prêtre en 1664. Dès lors, toute sa vie fut consacrée à l’étude et à la méditation. Disciple de Descartes, en même temps qu’ardent chrétien, après avoir reconnu comme son maître la distinction de l’étendue et de la pensée, il dénie à la seconde comme à la première toute puissance active. Dieu seul est cause : cause de l’existence des êtres, cause de leurs modifications, cause enfin des idées que nous en formons, lesquelles ne pouvant ni émaner des corps, ni être créées par notre pensée, ne sont aperçues par nous qu’en Dieu : c’est là ce qu’on appelle la théorie de la vision de Dieu.